Ce MOOC, créé en partenariat avec Le RAMEAU, a pour vocation de présenter les différentes modalités selon lesquelles entreprises, associations, et acteurs publics peuvent agir ensemble au service d'un territoire. En suivant ce MOOC, vous saurez : • Comprendre quels sont les enjeux et les principaux acteurs des territoires • Identifier les alliances pouvant se développer par et pour le territoire • Déterminer les étapes nécessaires à la construction d’une alliance territoriale • Et enfin, distinguer les facteurs et dispositifs permettant l’essaimage de ces initiatives Que vous soyez une entreprise responsable, une association dynamique, un acteur public innovant ou un citoyen engagé, ce MOOC est fait pour vous ! Cliquez ici pour visionner le teaser du MOOC : https://www.youtube.com/watch?v=_VfeWigBRCc
Parole d'expert : Guy Kauffmann, Directeur Général des Services du Conseil Général du Val d'Oise

Loading...
Reviews
4.6 (83 ratings)
- 5 stars69.87%
- 4 stars21.68%
- 3 stars7.22%
- 1 star1.20%
FF
Apr 6, 2018
Ce cours ouvre de nouvelles perspectives très encourageantes !
EN
Dec 28, 2016
des pareilles j'en trouve pas trop dans nos universités.
From the lesson
Qu’est-ce que le territoire et à quels enjeux les alliances territoriales permettent-elles de répondre ?
Au terme de cet épisode, vous saurez répondre aux 3 questions suivantes : 1) Qu’est-ce que le territoire, et quels en sont les acteurs principaux ? 2) Quels enjeux le territoire représente-t-il pour ses acteurs ? 3) Pourquoi co-construire en territoire ?
Taught By
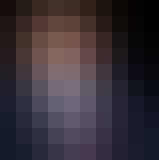
Thierry Sibieude
Professeur
